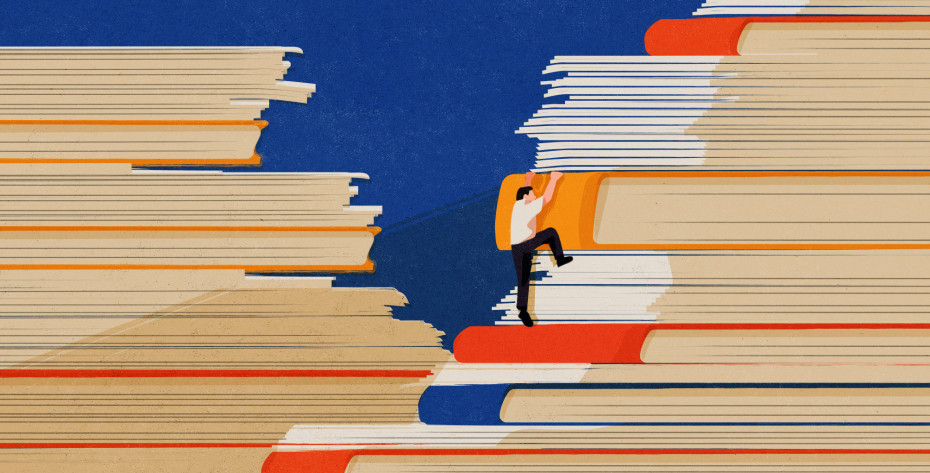
Dans les fonctions publiques, un système plus opaque
A la différence du privé, l’employeur public décide de l’imputabilité professionnelle des maladies déclarées par les agents. Zoom sur une procédure à part et troisième épisode de notre dossier « Maladies professionnelles : soigner la reconnaissance ».
Contraintes posturales et articulaires, port de charges, travail de nuit, exposition à des agents biologiques ou chimiques, manque de reconnaissance… Loin des clichés, la Dares a établi que les agents publics sont davantage exposés à ces conditions de travail difficiles que les salariés du secteur privé. « Etre fonctionnaire n’a rien d’un bouclier contre les risques professionnels », rappelle Loïc Lerouge, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de droit comparé du travail et de la Sécurité sociale à l’université de Bordeaux. Pourtant, les fonctionnaires relèvent d’un régime spécifique de reconnaissance des maladies liées au travail.
Ce système est parfois perçu comme moins favorable que le régime général. Une méfiance liée à son opacité : le nombre de reconnaissances n’est connu que pour une partie des agents publics et on ignore celui de l’ensemble des demandes. Aussi, les règles n’ont pas été appliquées de manière uniforme selon que les fonctionnaires travaillent pour l’Etat, les collectivités ou la fonction publique hospitalière. « L’application des textes et de la jurisprudence varie, selon les fonctions publiques et au sein de chacune d’elles », expliquait la Cour des comptes dans un rapport de 2006.
Un employeur juge et partie
La première particularité du régime public porte sur la place de l’employeur dans le processus de reconnaissance : c’est lui qui décide de l’imputabilité professionnelle d’une pathologie. Le service des ressources humaines diligente une enquête administrative, consulte le médecin de prévention et peut recourir à une expertise médicale. Il peut directement décider d’accorder le congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), mais, en cas de doute, il saisit le conseil médical pour avis.
Auparavant appelée « commission de réforme », le conseil médical se veut l’équivalent du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) du privé. Mais il s’en distingue par sa composition : trois médecins, deux représentants de l’administration, ainsi que deux représentants du personnel, chaque membre ayant droit de vote. « On arrive à infléchir des décisions, par exemple en apportant des éléments ou des témoignages sur les conditions de travail », explique Martine Harnichard, secrétaire générale de l’Unsa Alimentation Agriculture Forêts, qui représente les agents du ministère de l’Agriculture. Autre spécificité : l’agent, convoqué, peut prendre la parole en séance.
Toutefois, l’avis de cette instance demeure consultatif. « L’administration a un pouvoir propre d’appréciation. L’avis du conseil médical n’est qu’un acte préparatoire », explique l’avocate Christelle Mazza. Ainsi, « il arrive que les employeurs aillent contre les avis des conseils médicaux, observe sa consœur Perrine Athon-Perez.
Juges et parties, les employeurs peuvent-ils abuser de leur pouvoir ? Faute de données, il est difficile d’identifier des tendances. Certaines situations, comme un conflit ouvert entre la victime et l’employeur ou des problèmes de management, peuvent parasiter des dossiers. « On peut avoir des difficultés à faire reconnaître des maladies professionnelles liées à du harcèlement, car ce faisant, l’employeur reconnaît indirectement une forme de responsabilité sur un fait délictuel », rapporte Christelle Mazza.
« On ne peut pas affirmer que cela explique toujours cette situation, mais la reconnaissance par une collectivité locale ou une administration de l’imputabilité au service de la maladie de son agent a des incidences financières non négligeables », avance Perrine Athon-Perez. A l’inverse, l’avocate constate parfois « des décisions de reconnaissance d’imputabilité sur des dossiers médicaux fragiles ». Ces positions pourraient être liées à « la volonté de l’administration de ne pas pénaliser son agent ou d’éviter une situation conflictuelle ».
Un alignement récent sur le privé
L’autre spécificité du système tient aux règles suivies pour reconnaître les maladies. En pratique, les employeurs du public se réfèrent depuis longtemps aux tableaux du code de la Sécurité sociale. Le principe de pouvoir reconnaître d’autres pathologies provoquées par le travail est lui aussi acquis de longue date. Mais depuis une ordonnance de 2017 qui opère l’alignement complet avec les règles du privé, la loi les y oblige. Désormais, la présomption d’imputabilité s’applique pour toute maladie correspondant aux tableaux, inversant la charge de la preuve. Pour les cas ne remplissant pas toutes les conditions, en revanche, c’est toujours à l’agent de prouver un lien « direct ». Lequel doit être de surcroît « essentiel » pour les pathologies hors tableaux.
Jusqu’en 2017, « l’absence de présomption claire d’imputabilité [a] induit des conflits d’interprétation pour qualifier ce qui relève ou non de la maladie professionnelle et [donné] une place centrale de l’expertise médico-administrative », écrit la sociologue Marion Gaboriau dans un article [1] consacré à la procédure appliquée jusqu’en 2019 par la Ville de Paris.
Si la charge de la preuve s’allège pour les pathologies des tableaux, cette évolution n’a pas que des effets positifs. Paradoxalement, des avocats de victimes remarquent une plus grande difficulté à obtenir certaines reconnaissances d’imputabilité. L’instauration d’un seuil minimal de 25% d’incapacité permanente partielle (IPP) est perçue comme un obstacle, susceptible de freiner en particulier les dossiers de troubles psychiques. « Jusqu’ici, il y avait un avantage dans la fonction publique, car il n’y avait pas de taux. Désormais, ce critère est très fréquemment opposé aux agents pour refuser l’imputabilité au service de la maladie hors tableau, observe Perrine Athon-Perez. Idem avec la mise en place du délai pour effectuer une déclaration, de deux ans après constatation de la maladie et de son possible lien avec l’activité. Un paramètre qui a lui aussi diminué le champ des possibles. »
[1] De la fabrication de la preuve à la décision. Reconnaissance, droit et usage de la maladie professionnelle dans la fonction publique territoriale, Presses des Mines, 2021.